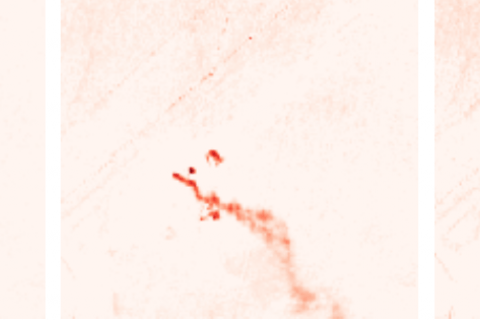Partenariat Centre Borelli - CNES
Le projet SMOS-HR
Le projet en cours concerne le satellite SMOS-HR, nouveau concept faisant suite à SMOS et sur lequel travaille le CNES. L’objectif du CNES est de gagner un demi ordre de grandeur en résolution tout en conservant la même sensibilité radiométrique, sans perturbation de RFI et sans aliasing et sans effet de ringing ! Un tel objectif implique des structures déployables dans l’espace de grandes dimensions. La réduction de ses structures (facteur proche de 2 en dimensions) peut être réalisée par des traitements sol de super-résolution et de débruitage. Les premiers dimensionnements d’un SMOS_HR réalisés au CESBIO indiquent que les caractéristiques spectrales des images seront comme dans SMOS de spectre incomplet. La super-résolution permet de combler ce spectre en débruitant. Il est envisageable de réduire le bruit dans un rapport deux et d’améliorer la résolution géométrique dans le même rapport.
Dans ce cadre, le Centre Borelli participe au développement de techniques mathématiques pour résoudre le problème du repliement spatial dû au sous-échantillonnage fréquentiel ainsi qu’au développement de techniques d’optimisation pour obtenir des configurations d’antennes irrégulières, ainsi que la calibration de ces configurations.
Le projet Sentinel
L'imagerie satellitaire passe de l'ère des photo-interprètes à celle de la surveillance automatique et du traitement des données volumineuses. L'Agence spatiale européenne a lancé deux satellites publics d'observation de la Terre, la constellation Sentinel1, qui produisent un flux régulier d'images radar à synthèse d'ouverture partout, tous les 3 à 5 jours, à une résolution de 3x10 mètres. En utilisant ces satellites récurrents en mode interférométrique et en utilisant la précision de leur retour, on peut "surveiller" la Terre par interférométrie, c'est-à-dire analyser par interférométrie de courtes séries temporelles et détecter des changements locaux significatifs du sol et des bâtiments, généralement causés par les activités humaines.
Ce projet vise à définir des procédures locales dans le temps et l'espace pour évaluer les petits mouvements relatifs des diffuseurs persistants par interférométrie dans l'imagerie satellitaire radar à ouverture synthétique (InSAR). Ceci est théoriquement possible en utilisant la technique de la "double différence de phase", dont le principe est d'estimer uniquement les différences de phase entre les réflecteurs persistants et les réflecteurs voisins. En effet, la réalisation de ces différences annule les effets circonstanciels dus à l'atmosphère, aux erreurs d'attitude des satellites, et aux propriétés des diffuseurs eux-mêmes. L'objectif applicatif du projet est de surveiller les installations industrielles et en particulier leurs déformations thermiques dues à l'activité humaine. Par ailleurs, et plus classiquement, un autre objectif est d'évaluer les déplacements locaux du sol causés par les processus de pompage, en particulier la fracturation hydraulique et l'exploitation des eaux souterraines. Les travaux seront menés sur les données de la constellation de satellites publics européens Sentinel-1 ainsi que sur les données de satellites commerciaux tels que COSMO-SkyMed. Le projet développera une méthode mathématique et statistique pour sélectionner non pas exactement les diffuseurs persistants habituels, mais plutôt des groupes de diffuseurs permanents ou "localement" persistants, en utilisant des techniques de géométrie stochastique pour établir des modèles a contrario permettant de détecter des groupes de diffuseurs cohérents en calculant leur nombre de fausses alarmes. Ceci n'a jamais été fait auparavant.
Le projet abordera également le problème de l'inversion modulaire de systèmes linéaires où les observations sont connues modulo la longueur d'onde du capteur, pour examiner dans un cadre général les méthodes spatio-temporelles de débrouillage de phase.
Le développement de ce projet au Centre Borelli, Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay, bénéficiera de son étroite collaboration avec la Tectonique et Mécanique de la Lithosphère de l'Institut de Physique du Globe de Paris.